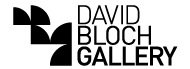Hors les murs « Dialogues avec le Losange » – ARTHUR DORVAL x SÉBASTIEN PRESCHOUX x SWIZ – Fondation Vasarely – Aix en Provence – 31 Octobre 2025 > 15 Février 2026
A l’occasion des 100 ans du losange Renault
En partenariat avec le Fonds Renault pour l’Art et la culture
Commissariat Karim Boukercha
Production David Bloch Gallery
Commissariat Karim Boukercha
Production David Bloch Gallery
—
Arthur Dorval, Sébastien Preschoux et Olivier Swiz investissent trois espaces emblématiques de la Fondation : le bureau historique de Vasarely, réactivé comme laboratoire immersif ; la salle 14H, transformée en atelier collectif; et les salles monumentales, où des sculptures entrent en résonance avec l’architecture du lieu. De l’intimité du lieu de création à la monumentalité architecturale, le parcours se déploie en trois temps, comme un dialogue vivant avec l’héritage vasarélien.
—
LE BUREAU DE VASARELY
« La cité polychrome du bonheur sera la cité de demain. »
— Victor Vasarely, Notes et discours sur la Cité polychrome du bonheur, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, 1976
(archives de la Fondation)
« La cité polychrome du bonheur sera la cité de demain. »
— Victor Vasarely, Notes et discours sur la Cité polychrome du bonheur, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, 1976
(archives de la Fondation)
En 1955, Victor Vasarely formule le rêve d’une « cité polychrome du bonheur » où l’art ne serait plus confiné aux musées mais intégré à l’architecture, présent dans les rues et accessible à tous.
Soixante-dix ans plus tard, l’art urbain donne corps à cet idéal d’un art vivant au cœur de la cité.
L’exposition Dialogues avec le losange réunit trois artistes héritiers de cet élan qui, comme lui, explorent l’abstraction géométrique, l’art optique et cinétique.
Imaginée pour les 100 ans du losange Renault, elle rassemble Arthur Dorval, Sébastien Preschoux et Olivier Swiz autour de cette forme emblématique. En 1972, Vasarely réinterpréte, en collaboration avec son fils Yvaral l’emblème de la marque pour en faire un symbole optico-cinétique. Élément clé de l’« alphabet plastique » vasarélien, le losange devient ici le terrain d’un dialogue intergénérationnel.
Cette rencontre investit le bureau historique de Vasarely, resté jusqu’ici fermé au public. L’artiste y conçut plusieurs projets majeurs d’intégration de l’art à l’architecture.
Au cœur de cet espace de travail, l’œuvre de Vasarely NB22 Caope (1970) incarne la formule du Manifeste jaune : « le losange égale carré + espace + mouvement + durée ». Le losange est un carré en mouvement.
En résonance avec cette œuvre, les trois artistes transforment le bureau en une déambulation kaléidoscopique où géométries architecturées, installations filaires et abstractions chromatiques composent un environnement vibrant.
Dans ce laboratoire retrouvé, la pensée de Vasarely se déploie dans le présent.
Soixante-dix ans plus tard, l’art urbain donne corps à cet idéal d’un art vivant au cœur de la cité.
L’exposition Dialogues avec le losange réunit trois artistes héritiers de cet élan qui, comme lui, explorent l’abstraction géométrique, l’art optique et cinétique.
Imaginée pour les 100 ans du losange Renault, elle rassemble Arthur Dorval, Sébastien Preschoux et Olivier Swiz autour de cette forme emblématique. En 1972, Vasarely réinterpréte, en collaboration avec son fils Yvaral l’emblème de la marque pour en faire un symbole optico-cinétique. Élément clé de l’« alphabet plastique » vasarélien, le losange devient ici le terrain d’un dialogue intergénérationnel.
Cette rencontre investit le bureau historique de Vasarely, resté jusqu’ici fermé au public. L’artiste y conçut plusieurs projets majeurs d’intégration de l’art à l’architecture.
Au cœur de cet espace de travail, l’œuvre de Vasarely NB22 Caope (1970) incarne la formule du Manifeste jaune : « le losange égale carré + espace + mouvement + durée ». Le losange est un carré en mouvement.
En résonance avec cette œuvre, les trois artistes transforment le bureau en une déambulation kaléidoscopique où géométries architecturées, installations filaires et abstractions chromatiques composent un environnement vibrant.
Dans ce laboratoire retrouvé, la pensée de Vasarely se déploie dans le présent.
—
SALLE 14H
En contrepoint à l’installation polychrome du bureau, Arthur Dorval , Sébastien Preschoux et Olivier Swiz présentent trois polyptyques d’ampleur architecturale en noir et blanc.
Ramenée à l’essentiel, cette approche monochromatique célèbre la pureté du contraste, force chère à Vasarely, tout en affirmant trois écritures singulières. Géométrie architecturée chez Swiz, vibration tonale chez Preschoux, tension des valeurs chez Dorval.
Pour cette œuvre commune, chaque artiste a réalisé un polyptyque de huit toiles.
Ces vingt-quatre unités ont été entremêlées pour former trois nouveaux polyptyques, créant un alphabet contemporain qui prolonge le principe vasarélien de variation combinatoire.
La genèse de cette création collective est révélée par une vidéo présentant l’œuvre de chaque artiste, aux multiples agencements possibles. Les formes deviennent les caractères de cet alphabet en mouvement, en perpétuelle variation.
« L’unité engendre la multiplicité ; la multiplicité recrée l’unité. C’est la loi du mouvement plastique. »
— Victor Vasarely, Notes Brutes, 1960
En contrepoint à l’installation polychrome du bureau, Arthur Dorval , Sébastien Preschoux et Olivier Swiz présentent trois polyptyques d’ampleur architecturale en noir et blanc.
Ramenée à l’essentiel, cette approche monochromatique célèbre la pureté du contraste, force chère à Vasarely, tout en affirmant trois écritures singulières. Géométrie architecturée chez Swiz, vibration tonale chez Preschoux, tension des valeurs chez Dorval.
Pour cette œuvre commune, chaque artiste a réalisé un polyptyque de huit toiles.
Ces vingt-quatre unités ont été entremêlées pour former trois nouveaux polyptyques, créant un alphabet contemporain qui prolonge le principe vasarélien de variation combinatoire.
La genèse de cette création collective est révélée par une vidéo présentant l’œuvre de chaque artiste, aux multiples agencements possibles. Les formes deviennent les caractères de cet alphabet en mouvement, en perpétuelle variation.
« L’unité engendre la multiplicité ; la multiplicité recrée l’unité. C’est la loi du mouvement plastique. »
— Victor Vasarely, Notes Brutes, 1960
—
LES SALLES ET LE BASSIN-MIROIR – Résonances spatiales et lumineuses
Dans les salles monumentales hexagonales de la Fondation, chaque artiste déploie une sculpture qui entre en résonance avec les intégrations architecturales de Vasarely. En confrontant leurs recherches à cet univers, ils prolongent les préoccupations spatiales, perceptives et chromatiques qui traversent l’abstraction géométrique et en démontrent la vitalité actuelle.
Dans la salle 5, Arthur Dorval transpose ses Éclosions géométriques en un grand relief miroitant qui démultiplie les reflets des œuvres monumentales de Vasarely. Par ce jeu de mise en abyme, la géométrie devient vibration lumineuse, engageant le spectateur dans un espace mouvant où son propre déplacement active l’œuvre. La sculpture entre en résonance avec les expérimentations réfléchissantes menées par Vasarely dès les années 1960, faisant du miroir un dispositif de participation perceptive.
Dans la salle 8, Sébastien Preschoux expose un premier mobile filaire tissé de lignes tendues et d’ombres mouvantes. En dialogue direct avec les compositions de Vasarely, cette structure aérienne prolonge la figure du losange dans la troisième dimension. Un second mobile se reflète sur le bassin-miroir, où l’eau démultiplie la forme par reflets mouvants. Par ce jeu de reflets, l’œuvre révèle l’ambiguïté vasarélienne entre forme réelle et image reflétée, faisant de la perception une expérience en perpétuelle transformation.
Enfin, dans la salle Lucien Arkas, au premier étage, Olivier Swiz présente une sculpture pensée spécifiquement pour cet espace.
Cette construction modulaire en bois reprend les principes de symétrie et de superposition de plans chers au mouvement optico-cinétique. Ouverte en son centre, elle cadre les compositions de Vasarely en arrière-plan, qui deviennent parties intégrantes de l’œuvre. Le déplacement du visiteur démultiplie les variations chromatiques et spatiales, la sculpture devenant un dispositif de vision qui actualise les œuvres de Vasarely.
Dans les salles monumentales hexagonales de la Fondation, chaque artiste déploie une sculpture qui entre en résonance avec les intégrations architecturales de Vasarely. En confrontant leurs recherches à cet univers, ils prolongent les préoccupations spatiales, perceptives et chromatiques qui traversent l’abstraction géométrique et en démontrent la vitalité actuelle.
Dans la salle 5, Arthur Dorval transpose ses Éclosions géométriques en un grand relief miroitant qui démultiplie les reflets des œuvres monumentales de Vasarely. Par ce jeu de mise en abyme, la géométrie devient vibration lumineuse, engageant le spectateur dans un espace mouvant où son propre déplacement active l’œuvre. La sculpture entre en résonance avec les expérimentations réfléchissantes menées par Vasarely dès les années 1960, faisant du miroir un dispositif de participation perceptive.
Dans la salle 8, Sébastien Preschoux expose un premier mobile filaire tissé de lignes tendues et d’ombres mouvantes. En dialogue direct avec les compositions de Vasarely, cette structure aérienne prolonge la figure du losange dans la troisième dimension. Un second mobile se reflète sur le bassin-miroir, où l’eau démultiplie la forme par reflets mouvants. Par ce jeu de reflets, l’œuvre révèle l’ambiguïté vasarélienne entre forme réelle et image reflétée, faisant de la perception une expérience en perpétuelle transformation.
Enfin, dans la salle Lucien Arkas, au premier étage, Olivier Swiz présente une sculpture pensée spécifiquement pour cet espace.
Cette construction modulaire en bois reprend les principes de symétrie et de superposition de plans chers au mouvement optico-cinétique. Ouverte en son centre, elle cadre les compositions de Vasarely en arrière-plan, qui deviennent parties intégrantes de l’œuvre. Le déplacement du visiteur démultiplie les variations chromatiques et spatiales, la sculpture devenant un dispositif de vision qui actualise les œuvres de Vasarely.
—
Textes : Karim Boukercha
Photos : Hervé Hôte – Fabrice Lepeltier – David Bloch Gallery
Photos : Hervé Hôte – Fabrice Lepeltier – David Bloch Gallery